
26 Août Stéphane Bouquet, le poète qui refusait les étiquettes, s’éteint à 57 ans
Il écrivait que « la mort est un insoluble problème de grammaire ». Dimanche 24 août, Stéphane Bouquet a quitté la scène à l’âge de 57 ans, emporté par un cancer du poumon. Mais ses livres, eux, restent debout sur nos étagères, comme des présences vibrantes. Scénariste, critique, danseur, essayiste et avant tout poète, il avait fait de l’inclassable son territoire, de l’écriture une expérience à la fois intime et collective.
Un artiste pluriel, entre cinéma, danse et poésie
Né en 1967 à Paris, Stéphane Bouquet commence sa carrière comme critique aux Cahiers du cinéma. Très vite, son amour des images croise celui des corps : il collabore avec la chorégraphe Mathilde Monnier, danse occasionnellement sur scène, puis signe plusieurs scénarios, notamment pour Sébastien Lifshitz (Traversée, Les Terres froides) et Valérie Mréjen.
Mais si Bouquet s’aventure dans tous les arts, c’est dans la poésie qu’il trouve sa respiration. Auteur d’une dizaine de recueils, dont Tout se tient (2023), Un peuple (2007), Nos Amériques (2010) et La Cité de paroles (2015), il a construit une œuvre libre, sensuelle, traversée par le désir et une constante interrogation sur le langage.
La poésie comme acte de relation
Chez Bouquet, pas de chapelles, pas de dogmes. Son écriture se tient à l’écart des clivages qui, dans les années 2000, opposaient « lyriques » et « littéraux ». La poétesse Véronique Pittolo le résumait ainsi :
« Son œuvre échappe à toute classification et rend caduques les éventuelles hiérarchies. »
Cette liberté s’accompagne d’une exigence formelle. Pour lui, la phrase était un espace d’accueil : accueillir le monde, les autres, le désir, mais aussi la fragilité du vivant. « Qu’est-ce qu’un poème, sinon la signature provisoire d’un accord ? » écrit-il dans Tout se tient. Sa poésie navigue entre la sensualité du corps et l’intelligence de la pensée, entre l’intime et le collectif. Dans Un peuple, il convoquait autant la communauté des poètes que la dimension politique du mot « peuple ».
Un héritier de la poésie américaine
Influencé par Frank O’Hara, John Ashbery et la modernité de la poésie américaine, Stéphane Bouquet aimait « déplacer » la langue française, jouer avec ses rythmes, ses ruptures, ses excès. Dans Nos Amériques, récit-poème traversé par New York et par le désir, il mêlait français et anglais, déformait les phrases, ouvrait des brèches syntaxiques :
« Càd la mort ici
est une personne non dramatique. »
Ses textes, comme ses lectures publiques, invitaient à une forme d’abandon attentif. Il ne s’agissait pas de « comprendre » la poésie, mais de l’éprouver. Bouquet, dans un de ses vers, déclarait : « Je déclare la solitude ouverte ». Sa littérature, elle, ouvrait toujours des passages.
La mort, en suspens
Stéphane Bouquet a longtemps gardé le silence sur la maladie qui l’a emporté. Discret, pudique, il n’en laissait filtrer que des échos dans ses derniers recueils. Sa phrase, tendue entre le désir et la finitude, touchait à l’essentiel. Dans Tout se tient, il écrivait :
« Nous n’avons aucun titre sur la vie, sur rien. »
Aujourd’hui, ses mots résonnent d’autant plus fort. Parce qu’ils disent la fragilité, la joie, l’éphémère. Parce qu’ils affirment que, même face à la mort, la langue peut continuer à chercher, à relier, à inventer.
On ne fait pas vraiment le deuil d’un écrivain : on le lit. Les recueils de Stéphane Bouquet, de Vie commune à La Cité de paroles, tracent une trajectoire singulière : celle d’un poète qui a refusé les hiérarchies, les étiquettes et les réponses faciles. Dans une époque de bruit, il aura défendu une autre manière de parler, de penser, d’aimer.
Ses livres restent là, sur nos tables, comme une invitation : continuer la phrase, reprendre le souffle.

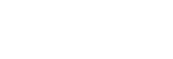



Pas de commentaire