30 Sep La poésie est poïétique
par Sylvestre Clancier, poète, Président de l’Académie Mallarmé et de la Maison de Poésie – Fondation Émile Blémont, fondateur du Grand Prix International de Poésie Léopold Sédar Senghor.
Le poète est potier : il a l’art du « Poïein » tel le démiurge dans le Timée de Platon.
Tentant de définir ce qu’est la singularité de la poésie, j’observe que la poésie est une langue première qui traverse l’espace et le temps. Elle est le vecteur des sensations et des émotions, ainsi que des perceptions et des questions qui façonnent l’humain depuis la nuit des temps.
Le poète s’adresse à la fragilité qui est en chacun de nous, il ne craint pas de l’éprouver pour dissiper la peur. Tel l’artisan potier façonnant peu à peu la tendre argile entre ses mains précautionneuses pour en faire un vase, une coupelle ou tout autre récipient destiné à recueillir ce qui sera la vie pour d’autres, le poète éprouve la fragilité existentielle qui est en lui, comme en chacun de nous. La révélant avec ses simples mots, ses interrogations, s’il nous touche, il nous permet de mieux accomplir ce qui fait notre humanité.
Le poète écrit à partir d’un manque éprouvé dès l’enfance et sans cesse approfondi par les questions qu’il se pose sur le pourquoi et sur le sens de notre présence au monde. Ses questions sont les questions premières que ceux qui ont renoncé face à l’énigme de l’homme et à celle de l’univers entier n’osent plus se poser. Il y a de l’interrogation métaphysique à l’origine de toute poésie.
La sensibilité toujours en éveil du poète laisse pénétrer en lui la beauté et les mystères de la nature, mais aussi la voix de l’autre, celle de toutes les visions, de tous les mythes, de toutes les cultures et de tous les savoirs. Le poète est amour.
Ainsi le poème devient une chaîne d’union entre les hommes. Il nous vient du passé, par le travail de mémoire auquel il nous incite, et tend vers l’avenir par l’appel et l’éveil qu’il inspire.
La poésie est poïétique, elle est comme l’univers en perpétuelle expansion, elle est constante ouverture à tous les possibles.
Tel le potier qui façonne formes et objets concrets entre ses mains à partir de la glaise informe, tel le forgeron qui avec le souffle de la forge, le marteau et l’enclume façonne le métal à sa guise, le poète, avec ses simples mots et les images qu’il convoque, célèbre les splendeurs et les affres du monde, évoque à la fois le mystère et le miracle des origines, la force et la fragilité de la vie et de l’être.
Pour moi, la poésie ne peut être l’innocence, elle est au contraire le questionnement, l’invocation, la célébration, l’indignation, la transgression. Elle use de tous les registres de la langue des hommes. Parce que le poète ne peut écrire qu’avec conviction, il exprime le meilleur de l’homme et s’insurge contre ce qui le rabaisse.
La langue des poètes a toujours été la langue de la résistance et de l’identité première des hommes et des peuples. Pendant la dernière guerre, si quelques écrivains ont collaboré, ce ne fut le cas d’aucun poète. Bien au contraire, ces derniers furent parmi les plus résistants, que l’on songe à Pierre Seghers, Pierre Emmanuel, Louis Masson, Georges-Emmanuel Clancier, Jean Lescure et sa revue Messages, René Tavernier et sa revue Confluences, Max-Pol Fouchet et sa revue Fontaine.
Oui, la poésie est le meilleur de la langue des hommes, elle est l’expression d’un véritable humanisme. Elle porte en elle la résistance de l’homme à l’inhumain et à la barbarie. Elle est énergie créatrice de liberté et de libération.
La poésie est une « transformation du feu » qui permet de vivre plus libre que le vent, et force est de constater que la seule langue qui soit véritablement commune aux hommes est celle de la poésie.
N’a-t-on pas coutume de dire que tout homme porte en lui un poète qui s’ignore ? Seulement pour révéler ce poète, il faut reconnaître que la part d’enfant qui est restée en nous est notre meilleure part.
Cette langue première qu’est la poésie n’est pas une langue innocente, je l’ai dit, elle est la véritable langue universelle, celle qui peut rapprocher les hommes les uns des autres. Elle n’est ni lisse, ni aimable, ni superficielle, ni vulgaire, mais grave et profonde. Elle interroge, elle questionne, elle dérange.
Le poète n’est pas un amuseur, il a des convictions. Il sait que l’enjeu pour lui consiste à dire l’homme tel qu’il est, à dire aussi ce à quoi il aspire. Il sait aussi que l’enjeu consiste à sauvegarder les identités culturelles, les diversités linguistiques, les styles de vie et à transmettre l’histoire des hommes aux autres hommes.
Le poète est transgressif : la poésie n’est-elle pas par nature un art de la transgression en ce qu’elle redonne un sens plus pur aux mots de la tribu, comme le souhaitait Mallarmé ?
Hugo transgresse le diktat du silence que Napoléon le petit aurait voulu imposer ; Baudelaire transgresse l’ordre moral ; Verlaine et Rimbaud élargissent la brèche ; Oscar Wilde affronte le jugement de ses contemporains ; Mallarmé frappe un grand coup avec son Coup de dés. Oui, tout grand poète est naturellement transgressif.
J’ai placé en tête de l’un de mes recueils les vers d’André Frénaud : Les légendes se forment sous nos pas… il est temps, pour souligner le rôle du poète qui est là pour sacrer le monde, l’honorer de son regard et de sa voix. Quand j’honore la mémoire de Gaston Miron, ardent défenseur de l’identité et de la langue de ses compagnons des Amériques, je ne fais que dire qu’à mes yeux tous les poètes vont « au rendez-vous de l’espérance », qu’ils sont les défenseurs de la liberté d’expression, de la diversité linguistique et culturelle, des droits de l’homme.
Le poète est un résistant : « La poésie est une arme chargée de futur », disait Raphaël Alberti. « Elle est une salve d’avenir », disait René Char. L’engagement des poètes se fait en référence à une mémoire et à une histoire. Garcia Lorca, Aragon, René Char, Mahmoud Darwich, Pablo Neruda… tous risquèrent leur vie en osant dire non.
Résister c’est vivre, c’est rester humain. Aussi les poètes constituent-ils un mouvement de résistance féconde dans tous les domaines à commencer par celui de la langue.
Le poète est fraternel : la valeur fraternité reste à accomplir. Et nous autres poètes devons montrer le chemin. Si nous ne voulons pas que l’humanité soit dissoute dans le marché, il nous faut valoriser une culture de l’échange, du don et de la gratuité.
Percevoir l’autre comme son frère, c’est reconnaître comme première et fondamentale l’humanité qui nous unit à l’ensemble des hommes. La fraternité est le parfait antidote du poison qu’est l’exclusion. Elle consiste à dire et reconnaître que toutes les femmes et les hommes doivent apprendre à vivre ensemble, par-delà leurs différences.
La fraternité est la vertu laïque et pacificatrice par excellence. Seule, elle peut nous éviter la cécité ravageuse à l’origine de tous les fanatismes et des grands désastres contemporains.
Seule, à son tour, la fraternité effective, au sein d’une société démocratique, permettra aux membres de vivre une véritable liberté et de promouvoir une véritable égalité.
C’est ce combat de la fraternité, antidote de l’exclusion et du fanatisme, qu’il nous faut, à nous autres poètes, mener aujourd’hui, si nous voulons être dignes de ceux qui, au XIXe siècle, engagèrent leur vie et leur liberté pour la défense de la justice sociale.
On voit bien là que la langue du poète n’a rien à faire avec l’innocence !
Sylvestre Clancier
Sylvestre Clancier, poète d’avant-garde des années 1960 / 1970, s’est passionné pour Cros, Jarry, Roussel, Borges, ainsi que pour Michaux, Caillois, Queneau, Soupault, Jouffroy, Miron. Il rencontre ces derniers. Il écrira sur Desnos, sur le Grand Jeu et Daumal.
Essayiste, critique littéraire, poète, il a présidé le P.E.N. Club français et a été membre du Comité Exécutif du P.E.N. International. Administrateur de la Société des Gens de Lettres, il y a présidé et animé les commissions de poésie, de la francophonie et des affaires étrangères.
Il a également été vice-président de la Fédération européenne des Sociétés d’auteurs (European Writers’ Council, Bruxelles).
Membre de l’Académie Mallarmé depuis 22 ans, il en est l’actuel président. Membre des Jurys Caillois et Grand Prix de la Critique littéraire, il a fondé le Grand Prix International de Poésie Léopold Sédar Senghor, attribué par La Nouvelle Pléiade, dont il a signé le premier manifeste en 2005.
Il préside à Paris la Maison de Poésie – Fondation Émile Blémont.
Auteur de trente livres de poésie, il a également publié des récits, des essais, des anthologies, a réalisé une soixantaine de livres de bibliophilie et coréalisé deux films.
Il intervient dans des universités françaises et étrangères et participe aux festivals internationaux de poésie. Son œuvre est présente dans de nombreuses anthologies de la poésie française contemporaine. Ses poèmes ont été traduits dans une quinzaine de langues.
Ses œuvres poétiques sont regroupées aux éditions La Rumeur libre.

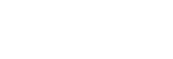




Pas de commentaire