
11 Sep Les manuscrits perdus des poètes : mythes et réalités
L‘Histoire de l’Art, au cours des époques, est parsemée de mystères, d’intrigues, d’anecdotes surprenantes concernant les artistes, leurs œuvres et les conditions de leurs créations.
En littérature, et en particulier en poésie, il existe un fantasme très souvent partagé autour des manuscrits des auteurs, essentiellement les manuscrits que l’on ne possède plus, disparus, perdus, sacrifiés ou volés, ou peut-être même n’ayant jamais existé mais dont la légende perdure dans des esprits convaincus de leur réalité.
Le problème est si réel qu’il a fait l’objet d’un séminaire durant toute une saison au Collège de France entre janvier et avril 2022.
Au cours de ce séminaire, l’essayiste et chercheur William Marx affirma : « Il y a plus d’œuvres perdues que d’existantes. La perte des œuvres est le cas général, pas leur conservation ».
En effet, dès que l’on se penche sur l’Histoire, force est de constater que pléthore d’œuvres ayant pourtant marqué les civilisations ne nous sont connues que par des recopiages, alors que bien peu d’observateurs ont pu se targuer d’avoir connu les originaux.
Les tragédies de Sophocle ou d’Eschyle, pourtant à l’origine du théâtre, ont disparu avec tous les volumes de la Bibliothèque d’Alexandrie lors des incendies qui la détruisirent au début de notre ère.
Plus près de nous, le poème de François Villon « Le roman du pot du diable » ne nous est connu que par des éditions très postérieures à l’auteur.
Perdues aussi la première version de « Hamlet » de William Shakespeare, l’»Anastasie » de Racine , tout autant que sa « Vie de Louis XIV » disparue dans l’incendie de sa maison occupée par son successeur Valincourt.
Nous manquent aussi les manuscrits de sept pièces de Molière écrites entre 1658 et 1661, ou la fin de l’œuvre magistrale de Cyrano de Bergerac (le vrai!), « L’histoire comique des états et empires du soleil ».
On pourrait aussi comptabiliser les disparitions de nombreuses partitions de Mozart, Haydn ou Beethoven.
L’histoire est pleine de ces mésaventures et rejoint d’ailleurs parfois l’anecdote, comme dans le cas de ces manuscrits d’Hemingway perdus par son épouse dans une valise oubliée dans un train en Gare de Lyon en 1922.
L’auteur en sera quitte pour réécrire de mémoire tout son roman « L’Adieu aux armes ».
La poésie n’est pas en reste et nous allons voir que nombreux sont les écrits revendiqués par des poètes alors que personne ou presque n’a pu les voir ou les lire, au point même que l’on doute parfois de leur réalité.

Arthur Rimbaud
À tout seigneur, tout honneur.
Penchons-nous sur le cas du poète qui a sans doute le plus suscité de fantasmes chez ses admirateurs, le plus biographié, scénarisé, interprété au cinéma, représenté au théâtre et jusqu’à la BD ou les jeux vidéo : Arthur Rimbaud.
À lui revient la paternité du plus mythique des manuscrits perdus : « La chasse spirituelle »
C’est Paul Verlaine (dont on connaît la relation amoureuse plus qu’orageuse qui le lia à Rimbaud), qui parle dans une lettre en 1872 d’un manuscrit en prose que son ami lui aurait confié sous pli cacheté entre 1871 – 1872. Pourtant, ce manuscrit Verlaine l’aurait lu puisqu’il affirme y avoir trouvé d’étranges mysticités et les plus aigus aperçus psychologiques ».
Malheureusement, d’après Verlaine, ce manuscrit « tomba dans des mains qui l’égarèrent sans bien savoir ce qu’elles faisaient ». En vérité, le poète accuse son épouse Mathilde d’avoir brûlé le document. Celle ci aura toujours nié, alors même qu’elle a reconnu avoir détruit la correspondance entre les deux hommes, correspondance qu’elle qualifiait d’ « obscène et démente ».
Coup de théâtre en 1949 : le journal « Combat » pense obtenir le scoop du siècle en affirmant avoir mis la main sur le manuscrit.
Tout de suite André Breton émit les plus extrêmes réserves.
Il avait raison, il s’agissait d’une supercherie avouée par deux auteurs, Nicolas Bataille et Atakia Viala à l’origine de l’imposture.
Bis repetita en 2012 : les éditions Leo Scheer publient un texte sorti d’on ne sait où mais attribué à Rimbaud, avec cette fois quelques réserves. Cela n’eut pas grand écho, les exégètes redoutant une nouvelle supercherie.
Mais « La chasse spirituelle » n’est pas le seul manuscrit prétendument perdu de Rimbaud !
Dans son ouvrage « Les poètes maudits » paru en 1884, Paul Verlaine (encore lui!),cite un poème, « Les veilleurs de la nuit » qu’il attribue à Rimbaud ; 52 vers en alexandrins sur la douleur causée par la chute de la Commune en 1871 :
« Les veilleurs de nuit, qui n’est plus hélas en notre possession, nous ont laissé l’impression la plus forte que jamais vers nous vinrent causer. C’est une vibration d’une largeur, d’une tristesse sacrée. Et d’un tel accent de sublime désolation que nous osons croire que c’est ce que Arthur Rimbaud a écrit de plus beau, de beaucoup ».
Verlaine ayant collecté de nombreux écrits chez des connaissances ou oubliés chez des éditeurs qui n’y ont pas vu intérêt, on peut raisonnablement penser qu’il ne s’agit pas là d’une affabulation.
Comme on aurait aimé lire ce poème !
Autre histoire autour de Rimbaud : « le cahier Labarrière »
Paul Labarrière, ami d’enfance de Rimbaud, a affirmé avoir reçu de lui un cahier de poésies qu’il aurait égaré lors d’un déménagement en 1885. Il s’agirait d’un cahier d’écolier cartonné souple, d’une quarantaine de pages, sans titre, contenant 50 à 60 poèmes de 3 à 4 strophes.
C’est ce qu’il déclare dans une interview au Mercure de France en 1933.
Rimbaud n’ayant rien publié entre novembre 1870 et février 1871, on peut penser que ce cahier (s’il existe) n’aurait été remis à son camarade qu’en 1871.
Labarrière disait se souvenir de quelques vers comme :
« Et le poète saoul engueulait l’univers »
ou bien
« …un pot de nuit banal
Reliquaire indécent des vieilles châtelaines
Courbe ses flancs honteux sur l’acajou royal »
Rien n’a pu depuis lors corroborer ces dires.
Enfin, dernière curiosité concernant notre poète prodige, un vers lui étant attribué cité par Octave Mirbeau dans un article paru dans Le Gaulois le 23 février 1885.
« et comme dit le poète Rimbaud, l’éternel craquement des sabots dans les cours »
Ce vers ne se rattache à aucun poème connu et Mirbeau n’est pas homme à l’avoir inventé car il cite Rimbaud à une époque où ce dernier n’est pas encore très connu ou célébré. Mais les deux auteurs ayant eu un ami commun, le peintre Jean-Louis Forain, peut-être Mirbeau avait-il ainsi eu connaissance de manuscrits du poète ?

Émile Nelligan
Autre auteur passé du statut de poète à celui de mythe et d’icône nationale, cette fois au Québec, Émile Nelligan, dont la vie tragique a alimenté les imaginations romantiques.
Émile Nelligan naît à Montréal en 1879. Il y décédera en 1941, à 61 ans, après avoir passé 42 ans en hôpital psychiatrique.
Il est aujourd’hui considéré comme le premier grand poète québécois, influencé par le symbolisme et le romantisme.
Interné à 20 ans (1899) pour schizophrénie, il le restera jusqu’à sa mort.
Sa première période d’écriture s’étend de 1896 à 1899. Il publie alors dans des revues et journaux et participe activement à la vie culturelle du Québec par des lectures lors de réunions publiques et privées. Mais il glisse progressivement vers le folie, vit cloîtré et compose des poèmes de plus en plus sombres dont son texte le plus emblématique « Le vaisseau d’or ».
Nelligan effectue sa dernière lecture publique le 26 mai 1899 devant un public enthousiaste qui accueille un autre de ses textes devenu plus tard célèbre : « La romance du vin »
… Ô le beau soir de mai ! Le joyeux soir de mai !
Un orgue au loin éclate en froides mélopées
Et les rayons, ainsi que de pourpres épées
Percent le cœur du jour qui se meurt parfumé
…
Les cloches ont chanté ; le vent du soir odore…
Et pendant que le vin ruisselle à joyeux flots,
Je suis si gai, si gai dans mon rire sonore
Oh ! Si gai, que j’ai peur d’éclater en sanglots.
Le poète est interné le 9 août 1899.
Doté d’une mémoire prodigieuse, il recopie dès lors durant son internement de mémoire ses poèmes anciens, dont « Le vaisseau d’or », car il n’a pas pu emporter avec lui ses manuscrits à l’hôpital. Il compose aussi de nombreux autres poèmes qu’il lit à ses visiteurs ou au personnel médical.
De cette première période d’écriture (1896-1899), seuls les manuscrits de 24 poèmes ont échappé à la destruction.
Pourtant, en 1904, son ami Louis Dantin publie le premier recueil des œuvres de Nelligan qui recèle 107 poèmes, dont le fameux « Vaisseau d’or ».
Dantin aurait-il gardé en sa possession des manuscrits originaux, ou bien serait-il, comme certains l’ont avancé, le véritable auteur de certains poèmes attribués à Nelligan ? Le doute est toujours de mise car tous les manuscrits (sauf 24) ont disparu.
Toujours est-il qu’entre la version du « Vaisseau d’or » publié en 1904 et la transcription autographe qu’en fait le poète lui-même en 1912, et qui est parvenue jusqu’à nous, il existe des différences.
Vaisseau d’or dont les flancs diaphanes
Révélaient des trésors que les marins profanes
Dégoût, Haine et Névrose, ont entre eux disputés.
Que reste-t-il de lui dans la tempête brève ?
Qu’est devenu mon cœur, navire déserté
Hélas ! Il a sombré dans l’abîme du rêve.
(version 1904)
Des 25 premières années d’internement (1899 – 1924) seuls nous sont restés 1 dédicace et 3 poèmes dont la fameuse transcription.
Nelligan change d’hôpital en 1925 et de cette date à son décès en 1941 provient la part la plus riche de ses manuscrits conservés.
En 1952 paraît une nouvelle édition de l’œuvre, contenant les 107 de 1904 augmentés de 35 textes parus dans les journaux avant l’internement et de 20 supplémentaires retrouvés dans une collection privée.
Depuis lors, Nelligan fait l’objet d’un véritable culte au Québec où essais, romans, pièces de théâtre et même un opéra lui ont été consacrés.

Guillaume Apollinaire
Restons sur les sommets de la poésie avec la charmante histoire du poème d’amour perdu de Guillaume Apollinaire.
Nous sommes le 2 janvier 1915.
Guillaume Apollinaire, militaire permissionnaire, a passé les fêtes à Nice avec sa maîtresse Lou (Louise de Coligny-Chatillon).
Il prend le train pour rejoindre son régiment à Nîmes. Dans son compartiment est déjà installée une jeune professeure de lettres en poste à Oran, Madeleine Pagès, qui doit prendre le bateau à Marseille après des fêtes en famille.
Une conversation débute entre eux, d’autant plus que la jeune femme lit un recueil de poèmes.
De cette rencontre inopinée découlera une liaison épistolaire et poétique suivie, d’abord sage, puis devenant amoureuse et progressivement torride.
Les jeunes gens décident de se fiancer sans s’être revus.
Apollinaire profite alors d’une nouvelle permission pour faire le voyage en Algérie en décembre 1915. À son retour, le charme semble rompu.
C’est alors que le poète subit une blessure au combat en mars 1916 nécessitant une trépanation. Lors de sa longue convalescence, il refuse que Madeleine vienne le visiter. Fragilisé par cette blessure, Apollinaire mourra de la grippe espagnole le 9 novembre 1918.
Madeleine ne se mariera jamais.
En 1952, paraît la correspondance entre Apollinaire et Madeleine. Le magazine MATCH à cette occasion vient interviewer Madeleine qui récite alors au journaliste, de mémoire, un poème dont le manuscrit a disparu ( à moins que la vieille dame à présent, n’ait pas voulu le dévoiler!)
« Ma fée, vous êtes devenue ma rose. Et c’est dans mon cœur que s’est fait la métamorphose. Ô rose du roman de ma vie. Et de la rose que vous êtes, Madeleine. Aux cheveux parfumés. Comme ceux de l’autre Madeleine. Qui aima et fut tant aimée. Et dont les longs cheveux parfumés de narée. Vêtaient seuls à La Sainte Baume Madeleine aux longs cheveux. Qu’un parfum de rose embaume »
Des disparitions tragiques
Pour d’autres poètes, la disparition des manuscrits est la conséquence de circonstances particulièrement tragiques. C’est le cas, par exemple, d’oeuvres disparues pendant la Deuxième Guerre Mondiale.
Bruno Schultz est un écrivain et dessinateur juif polonais né en 1892 et mort en 1942.
En 1941-1942 il vit dans le ghetto de Drohobycz alors que la Pologne est occupée par les nazis.
Remarqué pour son talent par un officier allemand, il va devenir son « esclave d’art » à charge pour l’artiste de produire des œuvres pour son « maître ».
Le 19 novembre 1942, alors qu’il va chercher du pain, il est tué dans la rue par un autre SS qui ne le connaît pas.
L’auteur travaillait alors à un roman « Le Messie »
Le manuscrit disparaît pendant de longues années. 40 ans plus tard il refait surface dans les archives du KGB. Le gouvernement polonais décide alors de le racheter et confie la transaction à un diplomate suédois.
Celui-ci récupère le manuscrit mais est alors victime d’un accident : sa voiture prend feu mystérieusement emportant dans les flammes définitivement le document.
Walter Benjamin est un philosophe et historien d’art juif allemand né en 1892, mort en 1940.
C’est un intellectuel, enseignant à l’Université d’Heidelberg, proche de Ernst Bloch, de Brecht, de Tristan Tzara, traducteur en allemand de œuvres de Saint-John Perse, Proust ou Paul Valéry.
En 1933, après la Nuit de Cristal, il fuit en France.
À cause de son statut d’apatride, à partir de septembre 1939 il est interné à Nevers dont il sera libéré en novembre.
Le 10 juin 1940, 4 jours avant l’arrivée des Allemands à Paris, il fuit d’abord à Lourdes, puis à Marseille, puis à Port-Vendres avec l’intention de passer en Espagne.Il arrive à Port-Bou grâce à des passeurs mais là son état de santé complique sa fuite. De plus, l’Espagne décide alors la reconduite des apatrides en France.
Se trouvant dans une impasse, Benjamin décide alors de se suicider à l’aide d’une dose massive de morphine.
L’auteur transportait avec lui dans sa fuite une serviette contenant un manuscrit qu’il qualifiait de « plus important que sa vie ».
Son corps n’a jamais été retrouvé. Quant à la serviette, bien que son contenu ait été répertorié à la police de Port-Bou en mentionnant bien une liasse de manuscrits, elle n’a jamais été retrouvée non plus.
Saint-John Perse, Alexis Léger (de son nom de plume Saint-John Perse) naît en 1887.
C’est un diplomate français originaire de Pointe-à-Pitre, germanophile, coauteur des accords franco-allemands de Locarno en 1925. Nommé Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères en 1933, il est secoué dans ses convictions par les Accords de Munich qui lui ouvrent les yeux sur la position de l’Allemagne.
Il sera dès lors démis de ses fonctions par Paul Reynaud en mai 1940 et il s’enfuit à Londres d’où, en désaccord avec de Gaulle, il gagnera les USA devenant conseiller de Roosevelt.
Déchu de sa nationalité par Vichy, son domicile parisien sera mis à sac par les troupes allemandes après sa fuite. Cette prise d’assaut aboutira à la destruction de cinq livres de manuscrits de poèmes. Les œuvres, écrites pendant ses années de service diplomatique, devaient être publiées après sa cessation normale de fonction.
Les destructions délibérées
Si de nombreuses disparitions furent involontaires, on assiste aussi dans l’Histoire à des destructions totalement voulues, volontairement décidées par les auteurs ou leurs ayants-droit.
Virgile demandera à l’empereur romain Auguste de détruire après sa mort le manuscrit de « l’Énéide » qui l’insatisfaisait. Heureusement, l’empereur n’en fera rien et le fera même publier incomplet, l’auteur étant décédé laissant son œuvre non finie.
Philippe Larkin né 1922, mort en 1985, est un poète et romancier anglais, considéré par certains comme le plus grand écrivain anglais de l’après-guerre. Selon ses vœux édictés sur son lit de mort, sa secrétaire et maîtresse déchiquettera et brûlera les 30 volumes de son Journal ainsi que d’autres ébauches d’écriture.
Terry Pratchett (1948 – 2015) auteur britannique de fantasy, va organiser les funérailles de ses brouillons.
Il donne des instructions pour que, après sa disparition, le disque dur de son ordinateur soit placé sous le passage d’un rouleau compresseur. Ses vœux seront exaucés en août 2017, deux ans après son décès.
Lord Byron
La disparition du manuscrit du Journal du poète fut, elle, effectuée dans des circonstances troublantes.
Byron meurt à 36 ans, le 19 avril 1824, à Missolonghi, en Grèce alors qu’il se bat pour l’indépendance de ce pays.
Son décès n’est connu à Londres que le 14 mai.
Le 17 mai, le manuscrit de son Journal, réputé infamant par son entourage, est brûlé par ses proches car la relation de la vie amoureuse tumultueuse du poète ne cadrait pas avec sa légende en train de prendre corps, et aurait pu faire de l’ombre à la vente de ses précédentes publications.
Le manuscrit, non destiné par l’auteur à être publié de son vivant, avait été confié par Byron à son ami Thomas Moore avec mention « d’en faire ce qu’il lui plaira » après sa mort.
Mais Moore, toujours désargenté, le vend du vivant de l’auteur à l’éditeur Murray avec une clause lui permettant de récupérer le manuscrit si remboursement de la somme versée.
Moore ne peut pas rembourser et le document reste propriété de Murray.
À la mort de Byron, une réunion de crise regroupe dans les bureaux de Murray, Augusta Leigh la maîtresse du défunt, John Cam Hobhouse son exécuteur testamentaire et amant, Annabella sa veuve, Moore et Murray. Chacun ayant intérêt à ce que le journal ne paraisse pas, tous donnent leur accord pour la destruction, soit pour éviter un scandale pouvant entacher leur réputation, soit pour éviter que ce scandale n’entrave la vente des autres livres de Byron.
Le manuscrit est alors immédiatement brûlé. Pourtant cela se saura et pendant de longues années la responsabilité en incombera à Thomas Moore.
De fausses disparitions
Parfois, des manuscrits déclarés perdus par leur auteur ne le sont pas vraiment.
Léopold Sédar Senghor a affirmé avoir perdu ses poèmes de jeunesse écrits entre 1928 et 1935. Cela n’est pas totalement vrai. En réalité, ces textes ont été restructurés plus tard par leur auteur, scindés, dupliqués, parfois cousus les uns aux autres, pour donner ultérieurement des œuvres présentées comme nouvelles.
Certains textes ont même été segmentés pour donner plusieurs poèmes indépendants.
les manuscrits retrouvés
Il faut tout de même terminer sur de bonnes nouvelles : certains manuscrits ont aussi été retrouvés ! C’est par exemple le cas de :
« Les 120 jours de Sodome » du Marquis de Sade. (avouons que nous sommes là un peu loin de la poésie…).
Le manuscrit écrit pendant le séjour de l’auteur à La Bastille, perdu le 14 juillet 1789, fut retrouvé par un révolutionnaire lors de la destruction de la prison, dissimulé dans un mur.
« Le condottiere », œuvre de Georges Perec égarée en 1966 pendant un déménagement, fut retrouvé en 1992, dix ans après la mort de l’auteur.
L’ensemble des manuscrits de Louis-Ferdinand Céline disparus en 1944, prétendus volés par l’auteur, après sa fuite et ses ennuis judiciaires liés à sa position durant l’Occupation, furent restitués anonymement en 2021 au journaliste Jean-Pierre Thibaudat, qui fut ensuite accusé d’en avoir effectué le recel. Lui accusant l’occupant de l’appartement de Céline après sa fuite, de les avoir trouvés et conservés ;
Et nous terminerons avec la belle et curieuse histoire de Phillis Wheatley, poète afro-américaine, la première esclave à être publiée.
C’est l’histoire d’une petite fille née en Afrique de l’ouest (Sénégal ou Gambie) aux alentours de 1753.
En 1761, à 8 ans, elle est capturée par des chasseurs d’esclaves et vendue à un négrier qui l’emmène en Amérique sur le bateau Le Phillis, ce qui lui donnera son prénom.
La fillette est fragile, souffreteuse, et donc vendue comme servante à la famille Weatley dont elle portera le nom, selon la coutume esclavagiste.
À la surprise générale, Phillis apprend seule l’anglais et l’alphabet en quelques mois. Les enfants de la famille décident alors de lui apprendre à lire et écrire, lui font lire la Bible et la littérature anglaise.
En 1767, à 14 ans, Phillis publie son premier poème dans un journal.
En 1773, elle a environ 20 ans, la ségrégation sévissant dans les colonies américaines, la famille Weatley favorise la publication de son premier livre en Angleterre et l’affranchit.
Le succès est immédiat en métropole et tous partent en Angleterre pour une tournée promotionnelle. Au retour, sur le bateau, la jeune femme se met à l’écriture d’un roman intitulé « Océans », histoire du premier voyage libre d’une Noire vers l’Amérique.
Le manuscrit disparaît.
Revenue en Amérique, les autorités l’obligent à passer un examen pour prouver qu’elle est bien l’auteure des poèmes publiés en Angleterre. Phillis passe l’épreuve avec succès et elle est enfin autorisée à sortir son livre dans les colonies.
Phillis connaîtra la célébrité tant que la famille Weatley la protégera.
Elle se marie en 1778 mais après la disparition de ses protecteurs, le racisme reprenant ses droits, elle mourra de tuberculose dans un total dénuement en 1784, à 31 ans.
Le manuscrit perdu ne sera retrouvé qu’en 1998 dans une vente aux enchères !
Infinie est la quête des manuscrits perdus ! …
Patrice Alzina est auteur, conférencier et essayiste. Il est également le lauréat 2025 du prix Yves Barthez de l’essai littéraire décerné par l’Académie des Jeux Floraux.

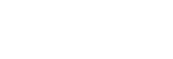



Pas de commentaire