
01 Oct Jacques Delille, le poète qu’on adorait haïr
Idole du XVIIIᵉ siècle, Jacques Delille fut adulé avant d’être voué aux gémonies. Poète des sciences et des jardins, célébré comme un nouveau Racine, il sombra brutalement dans le ridicule et l’oubli. Aujourd’hui, sa trajectoire paradoxale intrigue à nouveau chercheurs et critiques, qui redécouvrent derrière la caricature un laboratoire unique où poésie et savoirs modernes se sont affrontés.
Il fut l’idole d’un siècle, la star des salons et des académies, la voix que Paris accourait écouter. Jacques Delille (1738-1813) avait tout : la reconnaissance de ses pairs, l’adoubement du pouvoir, le succès de librairie. Ses Jardins (1782) et L’Homme des champs (1800) se vendaient par dizaines de milliers d’exemplaires, circulaient traduits jusqu’au Brésil, nourrissaient les débats entre savants et écrivains. Son nom s’inscrivait sur des monuments, ses vers ornaient la Grande Pyramide. À sa mort, la presse le rangeait sans hésiter à côté de Racine, Voltaire ou Corneille.
Et puis, brutalement, le couperet de la postérité s’est abattu. Moins d’une génération plus tard, Sainte-Beuve le réduisait au symbole d’une poésie fade, trop didactique, trop appliquée pour émouvoir. Delille devint le repoussoir commode : le poète « sans poésie », la caution de tous les manuels scolaires ennuyeux, l’incarnation d’un XVIIIᵉ siècle condamné pour excès de pédagogie. D’Hugo à Baudelaire, de Gautier à Verlaine, le nom même de Delille n’était plus qu’une cible. On l’étudiait pour mieux s’en moquer.
Une gloire dévorée par l’oubli
Le paradoxe est violent : Delille avait précisément innové. En traduisant Virgile puis en composant ses propres poèmes « scientifiques », il avait osé intégrer la modernité des savoirs à la langue classique. Ses alexandrins accueillent le mot « kangourou », s’autorisent à parler de fumier, de volcanisme ou de tungstène. Ses notes en prose s’écrivent parfois avec l’aide de Cuvier. En pleine Révolution et sous l’Empire, Delille croyait possible d’unir poésie et sciences, de rendre sensible le « merveilleux vrai » des découvertes contemporaines.
Mais le XIXᵉ siècle romantique, friand de lyrisme personnel et d’inspiration sublime, a vite tourné le dos à cette tentative. Le triomphe de Delille devint la preuve, pour ses détracteurs, de l’aveuglement d’une époque. Dès lors, la « poésie scientifique » fut frappée d’impossibilité : écrire comme Delille, c’était courir le risque d’être ridiculisé.
La « matière Delille », un laboratoire critique
Depuis quelques années pourtant, chercheurs et critiques réévaluent cette trajectoire. Hugues Marchal, à travers son projet collectif Reconstruire Delille, insiste sur la richesse de cette « matière » : non seulement des textes, mais aussi un réseau de pratiques – lectures publiques, inscriptions monumentales, collaborations avec des savants, innovations éditoriales. Delille incarne un moment où poésie et science dialoguent, s’affrontent, s’interpénètrent. Relire ses œuvres, c’est rouvrir un dossier longtemps verrouillé par le mépris romantique.
Certes, tout n’est pas chef-d’œuvre. Mais dans Les Trois règnes de la nature (1808), certains passages étonnent par leur énergie descriptive, leur manière de transformer un cours de botanique en cavalcade poétique. Dans L’Homme des champs, la genèse d’un grain de sable devient un moment de vertige cosmique. Delille n’est plus seulement le poète de la périphrase ; il s’affirme aussi comme un expérimentateur, qui teste les limites du vers et confronte la langue poétique au vocabulaire du savoir.
Le danger d’être Delille
Aujourd’hui, relire Delille, c’est affronter un paradoxe : comment un auteur célébré comme un géant a-t-il pu basculer en quelques décennies dans l’oubli complet ? La formule de Francis Ponge résume le sort : « danger à être Delille ». Danger de croire qu’on peut unir science et poésie ; danger d’être éclipsé par l’évolution rapide des goûts ; danger enfin d’être caricaturé par la postérité.
Mais ce danger est aussi ce qui rend Delille passionnant. Sa poésie, qu’on la trouve brillante ou pesante, témoigne d’un moment crucial : l’entrée des sciences dans la culture moderne, et la tentative – avortée mais éclatante – de leur donner une langue poétique. Delille, poète tombé dans la « matière noire » de l’histoire littéraire, redevient aujourd’hui un objet incandescent de critique : non pas un modèle à suivre, mais un terrain à explorer pour comprendre ce que poésie et sciences peuvent encore s’échanger
Pourquoi lire Delille aujourd’hui ?
Parce qu’il raconte à lui seul une énigme littéraire : comment un auteur célébré comme un géant a-t-il pu sombrer si vite dans l’oubli ? Idole des salons et des académies, Delille a incarné l’alliance audacieuse de la poésie et des savoirs scientifiques. Dans ses vers, on croise aussi bien la botanique que le volcanisme, les animaux exotiques que les métaux rares. Ce « poète des sciences » voulait rendre sensible le monde réel, traduire en alexandrins le vertige des découvertes de son temps.
Loin d’être un simple rhéteur académique, il a expérimenté les limites de la langue poétique, testant une modernité dont nous percevons aujourd’hui toute la singularité. Son destin, fait de gloire absolue et de rejet brutal, éclaire aussi la violence des goûts littéraires : hier adulé, aujourd’hui méprisé, Delille oblige à s’interroger sur ce que la postérité choisit de retenir – ou d’effacer.
Le relire, ce n’est pas chercher un nouveau classique à canoniser, mais redonner voix à une tentative inédite : unir art et science, sensibilité et savoirs, dans une poésie qui parle autant de l’histoire de la littérature que de nos débats actuels.
Les jardins ou L'art d'embellir les paysages
Chant 1 (extrait)
Le doux printemps revient, et ranime à la fois
Les oiseaux, les zéphirs, et les fleurs, et ma voix.
Pour quel sujet nouveau dois-je monter ma lyre?
Ah! Lorsque d’ un long deuil la terre enfin respire ;
Dans les champs, dans les bois, sur les monts d’alentour.
Quand tout rit de bonheur, d’espérance et d’amour,
Qu’un autre ouvre aux grands noms les fastes de la gloire ;
Sur son char foudroyant qu’il place la victoire ;
Que la coupe d’Atrée ensanglante ses mains :
Flore a souri ; ma voix va chanter les jardins.
Je dirai comment l’art embellit les ombrages,
L’eau, les fleurs, les gazons, et les rochers sauvages ;
Des sites, des aspects sait choisir la beauté ;
Donne aux scènes la vie et la variété :
Enfin l’adroit ciseau, la noble architecture,
Des chefs-d’œuvre de l’art vont parer la nature.
…

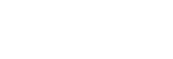



Pas de commentaire