
09 Oct Arthur Rimbaud – six mois en enfer
En 51 minutes d’une rare densité, le documentaire de Flore-Anne d’Arcimoles, diffusé sur Arte TV, ressuscite le Paris incandescent de 1871, quand un jeune poète de 16-17 ans conquiert la capitale et déclenche la légende Rimbaud. Grâce aux voix envoûtantes de Zaho de Sagazan et Félix Moati, et à un montage visuel audacieux, le film insuffle une urgence contemporaine à cette fulgurance littéraire.
Quand la caméra s’allume, c’est d’abord une toile d’archives — un cliché du Paris fin XIXᵉ — qui vacille sous nos yeux, animé de collages de couleurs vives, de traits ocres et de pulsations visuelles. Le documentaire « Arthur Rimbaud, six mois en enfer » s’impose comme une traversée épique du séjour parisien du poète, au moment clé de septembre 1871 à début 1872. Une période de feu, de bascule, qui forge l’adolescent en mythe.
Reconstitution et invention visuelle
Flore-Anne d’Arcimoles, co-auteure avec Grégoire Kauffmann, puise dans les fonds d’archives pour reconstituer un Paris encore marqué par la Commune. Peu à peu, ce matériau documentaire est saturé, métamorphosé : les visages s’effacent, les rues s’enflamment ou se figent, le temps se plisse en éclats d’images. Le montage opère comme une transe, convoquant le vertige poétique, plus que l’exactitude historique.
L’esthétique agressive n’est jamais gratuite : elle épouse la fulgurance du versement rimbaldien. Les archives dialoguent avec l’expérimentation graphique — aplats colorés, surimpressions, effets psychédéliques — pour suggérer l’invention d’une langue et d’un regard radicalement nouveaux.
Deux voix pour incarner le poème
Le documentaire fonctionne sur une double partition : la lecture des poèmes confiée à Zaho de Sagazan, la narration assurée par Félix Moati. La chanteuse prête à Rimbaud une diction dense, incantatoire ; l’acteur trace le récit, relie les fragments, canalise le tumulte. Cette alternance entre voix poétique et voix documentaire permet au spectateur de ressentir le frisson d’un langage en train de se faire — et non simplement de l’entendre.
Le film choisit de circonscrire son propos à une fenêtre brève — celle où Rimbaud quitte les Ardennes, débarque à Paris, déclame Le Bateau ivre devant les Parnassiens et entame une relation destructrice avec Verlaine. La précision historique est au cœur de la démarche : Rimbaud a 16-17 ans lors de son arrivée en 1871, il entre en contact avec le milieu parnassien, notamment via Théodore de Banville, puis avec Verlaine.
L’un des moments les plus forts est la scène de déclamation publique du Bateau ivre devant les membres du Parnasse, « fin septembre 1871 », où Rimbaud « sidère l’assemblée ». Mais le documentaire ne s’y arrête pas : il montre aussi la fragilité, les tensions, l’agitation d’une capitale prête à exploser et un poète prêt à tout briser pour arriver.
Limites et audace
Ce choix de forme, si vibrant, implique quelques concessions : certaines transitions se font en ellipses, des données biographiques peuvent paraître résumées ou fragmentaires. Le film ne prétend pas à l’exhaustivité d’une biographie universitaire, mais à une expérience sensorielle et sensible. Il reste parfois flou sur la chronologie exacte des correspondances, mais c’est conscient — le propos est de donner à ressentir.

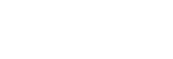



Pas de commentaire